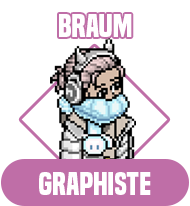Et si on remontait le temps pour découvrir comment fonctionnait la justice entre le XVe et le XVIIIe siècle ? Pas de code pénal bien rangé, pas d’avocats à la télé, encore moins de présomption d’innocence… À l’époque moderne, la justice est une affaire sérieuse, parfois cruelle, souvent arbitraire, et surtout très différente de celle que l’on connaît aujourd’hui.
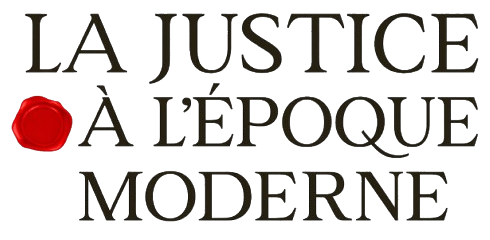
 Entre le XVe et le XVIIIe siècle, la France (et plus largement l’Europe) est un vaste terrain judiciaire où la justice dépend du statut social. Un noble ne sera pas jugé comme un paysan. Le clergé a ses propres tribunaux, les villes les leurs, et bien sûr, le roi a toujours le dernier mot. Il existe une véritable mosaïque de justices : seigneuriale, ecclésiastique, royale, urbaine… Les juridictions sont multiples, parfois concurrentes, et cela peut rendre les choses bien compliquées. Heureusement (ou pas), celui qui détient la justice suprême, c’est le roi. Sous l’Ancien Régime, on parle de "justice déléguée" : le roi est censé rendre la justice, mais comme il ne peut pas tout faire, il délègue cette tâche à ses juges.
Entre le XVe et le XVIIIe siècle, la France (et plus largement l’Europe) est un vaste terrain judiciaire où la justice dépend du statut social. Un noble ne sera pas jugé comme un paysan. Le clergé a ses propres tribunaux, les villes les leurs, et bien sûr, le roi a toujours le dernier mot. Il existe une véritable mosaïque de justices : seigneuriale, ecclésiastique, royale, urbaine… Les juridictions sont multiples, parfois concurrentes, et cela peut rendre les choses bien compliquées. Heureusement (ou pas), celui qui détient la justice suprême, c’est le roi. Sous l’Ancien Régime, on parle de "justice déléguée" : le roi est censé rendre la justice, mais comme il ne peut pas tout faire, il délègue cette tâche à ses juges.
Les magistrats sont appelés "robins" car ils portent la robe, et ils appartiennent souvent à une même caste : celle des gens instruits, issus des milieux aisés. La formation juridique passe par les universités, où l'on étudie le droit romain et le droit coutumier… en latin, bien sûr ! Le procès n’a rien d’un grand show. Les audiences sont rarement publiques, et les décisions sont souvent prises par écrit, loin du peuple. On parle de procédure inquisitoire : le juge enquête, pose les questions, dirige l’instruction. L’accusé peut avoir bien du mal à se défendre… À l’époque moderne, punir, c’est aussi montrer. Pour dissuader les criminels, on frappe fort et surtout, on frappe en public. On coupe, on pend, on roue, on brûle… Le supplice devient un spectacle, parfois annoncé comme une vraie "fête" dans les villes. Certaines peines font frissonner : la question (la torture pour obtenir des aveux), la roue, ou encore le bûcher pour les hérétiques ou les sorcières. Mais attention : tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Les nobles, par exemple, ont souvent droit à la décapitation, considérée comme plus "digne".
 La justice est intimement liée à la religion. On considère que le roi tient son pouvoir de Dieu, donc sa justice est aussi sacrée. C’est pourquoi certains crimes, comme le blasphème, l’hérésie ou la sorcellerie, sont jugés très sévèrement : ils mettent en danger non seulement la société, mais aussi l’ordre divin. Des tribunaux religieux, comme l’Inquisition, traquent les "mauvais croyants". Et les procès de sorcellerie, très nombreux au XVIe siècle, montrent à quel point la frontière entre crime, péché et superstition est floue.
La justice est intimement liée à la religion. On considère que le roi tient son pouvoir de Dieu, donc sa justice est aussi sacrée. C’est pourquoi certains crimes, comme le blasphème, l’hérésie ou la sorcellerie, sont jugés très sévèrement : ils mettent en danger non seulement la société, mais aussi l’ordre divin. Des tribunaux religieux, comme l’Inquisition, traquent les "mauvais croyants". Et les procès de sorcellerie, très nombreux au XVIe siècle, montrent à quel point la frontière entre crime, péché et superstition est floue.
Au XVIIIe siècle, le vent des Lumières commence à souffler sur la justice. Des penseurs comme Beccaria ou Voltaire dénoncent la torture, les supplices et les abus. On commence à parler de droits de l’homme, de raison, de peines utiles plutôt qu’infligées pour faire peur. Les réformes se multiplient, notamment sous Louis XVI, qui abolit la question préalable (torture avant l’exécution) en 1780. Mais il faut attendre la Révolution française pour que la justice change radicalement : création d’un droit écrit, égalité devant la loi, fin des privilèges judiciaires…