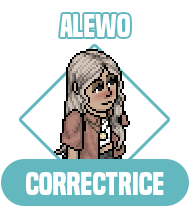Aujourd’hui, on parle des saisons comme d’un rythme évident : printemps, été, automne, hiver. Mais pourquoi a-t-on divisé l’année ainsi ? Et qui a décidé qu’il y aurait quatre saisons, ni plus ni moins ?

 Bien avant l’invention des calendriers, les hommes ont remarqué que la nature fonctionnait par cycles. Les jours rallongent, puis raccourcissent, les récoltes reviennent chaque année au même moment, et certains animaux migrent toujours à la même période. Chez les Égyptiens, il n’était pas question de quatre saisons, mais de trois, directement liées au Nil : Akhet (l’inondation), quand le fleuve débordait et irriguait les terres ; Peret (la germination), le temps des cultures et Shemu (la récolte), la période des moissons. Ces trois temps réglaient toute la vie économique et religieuse de la vallée du Nil.
Bien avant l’invention des calendriers, les hommes ont remarqué que la nature fonctionnait par cycles. Les jours rallongent, puis raccourcissent, les récoltes reviennent chaque année au même moment, et certains animaux migrent toujours à la même période. Chez les Égyptiens, il n’était pas question de quatre saisons, mais de trois, directement liées au Nil : Akhet (l’inondation), quand le fleuve débordait et irriguait les terres ; Peret (la germination), le temps des cultures et Shemu (la récolte), la période des moissons. Ces trois temps réglaient toute la vie économique et religieuse de la vallée du Nil.
Chez les Grecs et les Romains, en revanche, on retrouve déjà une division proche de la nôtre. Hésiode, poète grec du VIIIe siècle av. J.-C., parle du printemps, de l’été et de l’hiver, tandis que d’autres traditions grecques ajoutent une quatrième saison, l’automne, qui devient officielle chez les Romains.
La réponse se trouve dans le ciel ! La Terre est inclinée sur son axe de 23,5° par rapport au Soleil. En tournant autour de lui, elle provoque un changement dans la durée des jours et l’intensité de la lumière selon les mois. Quand le Soleil est au plus haut (solstice d’été), les journées sont longues et chaudes. Quand il est au plus bas (solstice d’hiver), elles sont courtes et froides. Entre les deux, les équinoxes (printemps et automne) marquent l’équilibre : jour et nuit de même durée. Ces quatre grands moments astronomiques ont naturellement donné naissance à quatre saisons dans les régions tempérées comme l’Europe.
Ces quatre grands moments astronomiques ont naturellement donné naissance à quatre saisons dans les régions tempérées comme l’Europe.
Les saisons ne sont pas qu’un phénomène naturel, elles sont devenues une invention sociale et culturelle. Le calendrier julien, introduit par Jules César en -46, s’est basé sur l’année solaire et a fixé douze mois qui correspondent encore aux nôtres. Et le calendrier grégorien, instauré en 1582 par le pape Grégoire XIII, a corrigé le décalage accumulé pour réaligner les dates des saisons avec leur réalité astronomique. Grâce à cela, nous pouvons encore aujourd’hui dire avec précision « le printemps commence le 20 mars ».
Toutes les cultures n’ont pas choisi le même découpage. Par exemple, en Inde, la tradition distingue six saisons, dont la mousson et l’automne précoce. Au Japon, les saisons sont associées à des symboles culturels très forts, et certaines périodes intermédiaires (comme la floraison des cerisiers) sont presque considérées comme des saisons à part entière. Sous les tropiques, les habitants parlent surtout de deux grands temps : la saison sèche et la saison des pluies.