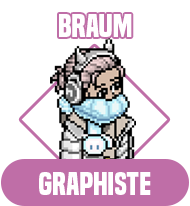L’Histoire est souvent racontée à travers des faits, des dates et des personnages célèbres. Pourtant, derrière chaque événement se cachent des peurs profondes, des angoisses collectives et des phobies qui ont façonné les sociétés. Ces peurs ont souvent été les moteurs de décisions politiques, de mouvements sociaux et même de conflits majeurs. Plongeons ensemble dans ces grandes peurs qui ont fait frissonner l’Histoire.

 À l’époque des grandes découvertes (XVe-XVIe siècles), l’inconnu s’étendait bien au-delà des horizons visibles. Océans mystérieux, terres inexplorées et peuples inconnus suscitaient fascination, mais aussi terreur. Pour les Européens, la peur de l’inconnu était un mélange d’admiration et d’effroi, alimenté par les récits d’aventures, mais aussi par des superstitions liées aux monstres marins et aux malédictions. Cette peur a souvent justifié la violence coloniale et l’imposition de croyances occidentales sur d’autres civilisations.
À l’époque des grandes découvertes (XVe-XVIe siècles), l’inconnu s’étendait bien au-delà des horizons visibles. Océans mystérieux, terres inexplorées et peuples inconnus suscitaient fascination, mais aussi terreur. Pour les Européens, la peur de l’inconnu était un mélange d’admiration et d’effroi, alimenté par les récits d’aventures, mais aussi par des superstitions liées aux monstres marins et aux malédictions. Cette peur a souvent justifié la violence coloniale et l’imposition de croyances occidentales sur d’autres civilisations.
Entre les XVIe et XVIIe siècle, en Europe, la peur de la sorcellerie et de l’hérésie s’est transformée en une véritable hystérie collective. La chasse aux sorcières a fait des dizaines de milliers de victimes, principalement des femmes accusées de pactiser avec le diable. Cette peur nourrissait la méfiance envers le voisin, le rejet des différences, et s’appuyait sur des croyances religieuses très fortes. Elle a profondément marqué la culture et l’imaginaire collectif, laissant une trace durable dans les mentalités.
Le XXe siècle a vu naître des peurs inédites, notamment celle du totalitarisme. Les dictatures fascistes et communistes ont imposé un climat d’oppression où la surveillance, la dénonciation et la répression ont terrorisé des millions de personnes. Cette peur a façonné la politique mondiale, menant à des guerres, à la guerre froide et à la course aux armements nucléaires. Le souvenir des camps, des purges et des exécutions sommaires continue d’alerter les sociétés modernes sur les dangers des régimes autoritaires.
 Après les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki en 1945, une nouvelle peur a émergé : celle d’une annihilation totale par l’arme nucléaire. Pendant la guerre froide, la menace d’un holocauste nucléaire a paralysé le monde. Des générations entières ont grandi avec cette angoisse latente, symbole d’une époque où la science pouvait à la fois créer et détruire la vie humaine en un instant. Cette peur a aussi nourri les mouvements pacifistes et la culture populaire, avec des films et des livres apocalyptiques.
Après les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki en 1945, une nouvelle peur a émergé : celle d’une annihilation totale par l’arme nucléaire. Pendant la guerre froide, la menace d’un holocauste nucléaire a paralysé le monde. Des générations entières ont grandi avec cette angoisse latente, symbole d’une époque où la science pouvait à la fois créer et détruire la vie humaine en un instant. Cette peur a aussi nourri les mouvements pacifistes et la culture populaire, avec des films et des livres apocalyptiques.
Aujourd’hui, la peur la plus diffuse et la plus urgente est celle du changement climatique. Face aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, à la montée des océans, à la perte de biodiversité, le sentiment d’impuissance et d’inquiétude s’est globalisé. Cette peur pousse les sociétés à repenser leurs modes de vie, leurs économies et leurs responsabilités, marquant une fracture entre ceux qui veulent agir et ceux qui nient encore l’évidence. Les grandes peurs historiques ont souvent été le reflet de crises profondes entre la crise économique, politique, sociale ou spirituelle. Elles révèlent aussi les limites humaines face à ce qui échappe à leur contrôle. Mais elles sont aussi des leviers puissants pour le changement. Qu’il s’agisse de lutter contre les superstitions, de résister à l’oppression, ou de repenser notre rapport à la planète, ces peurs sont des forces motrices.